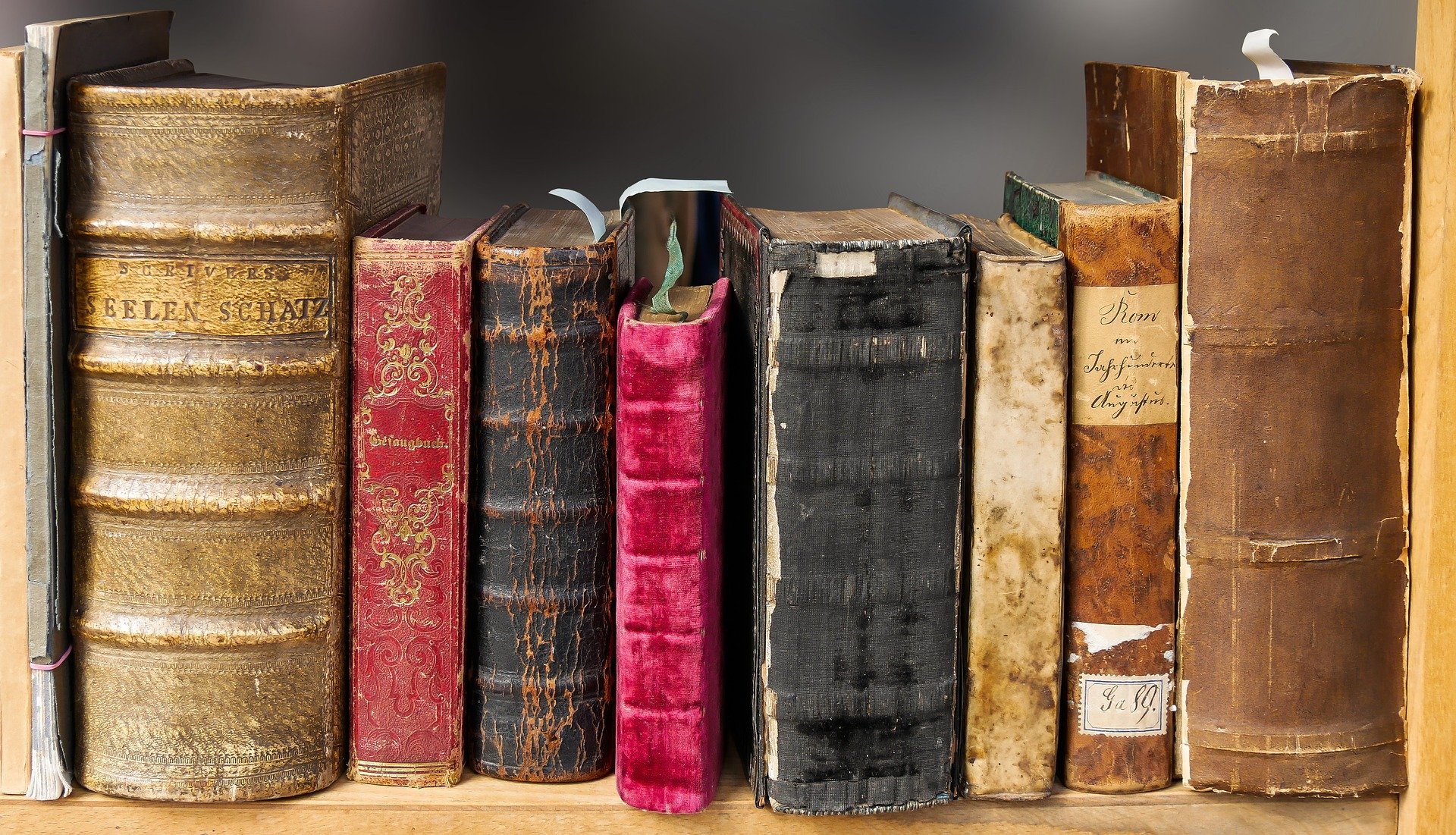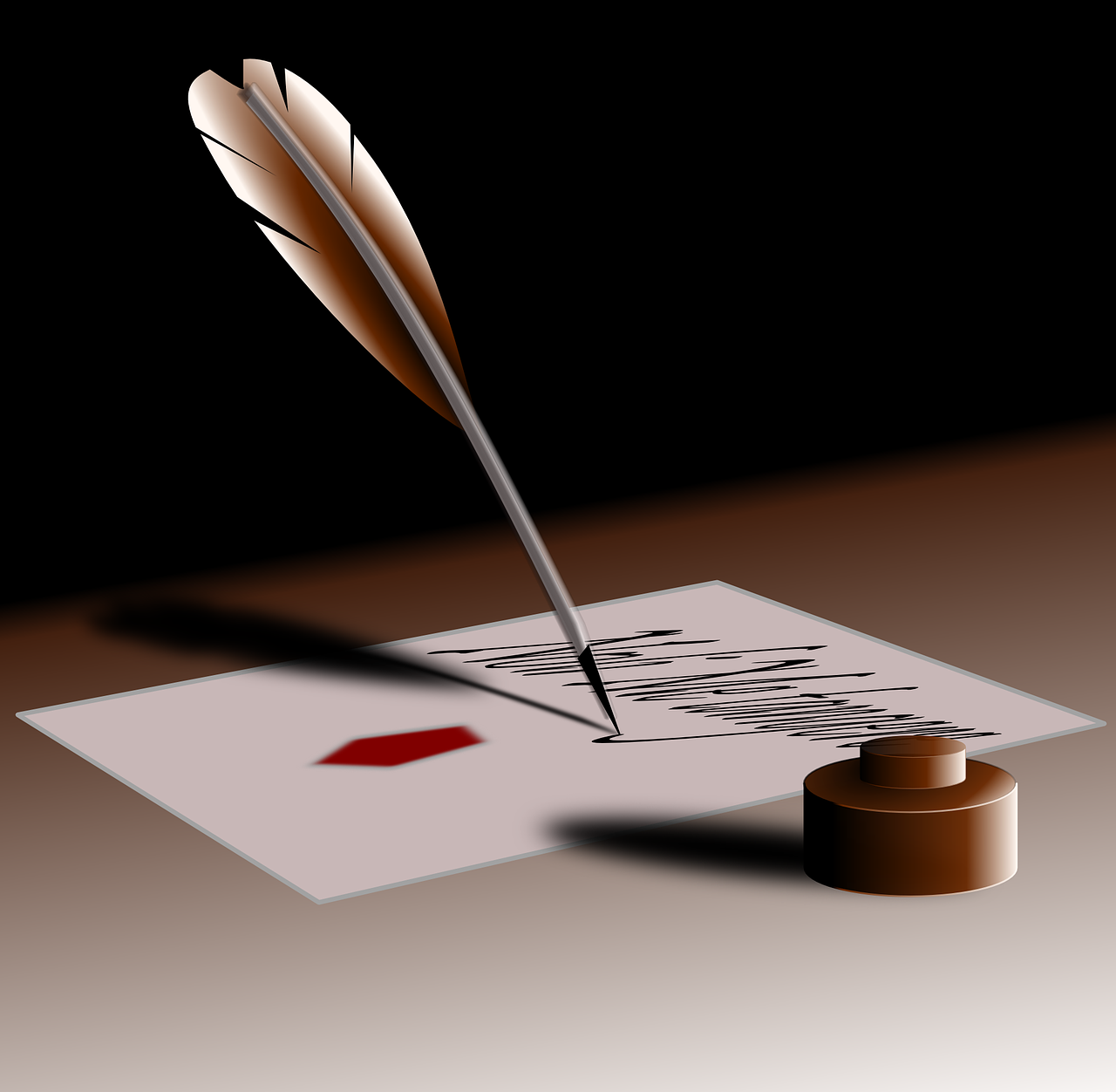Lettres persanes (Montesquieu)
Un bref rappel du début de la séquence que vous avez peut-être oublié :
Le 6 mars, vous a été présentée la séquence : vous pouvez télécharger le diaporama et la carte mentale ci-dessous.
Le 7 mars, nous nous sommes penchés sur trois représentations picturales de l'Orient (séance 2). Rappelez-vous, il s'agissait du Bain turc, de La Mort de Sardanapale et d'Odalisque, femme algérienne.
Le 10 mars (séance 3), il n'y a pas si longtemps, nous nous sommes interrogés sur la place de la religion dans le roman de Montesquieu : les lettres 12, 18, 24, 57 et 67 nous ont servi d'appui.
Le 13/03 (séance 4), nous avions grammaire... et non piscine ! Quel cauchemar ! Au menu du jour, les propositions subordonnées complétives, les propositions subordonnées circonstancielles et les propositions subordonnées relatives.
Enfin, plus proche de nous, nous avons étudié linéairement la lettre 30 et avons ciblé l'objet de la critique dans cette lettre : l'ethnocentrisme parisien (séance 5).
Place à la suite !
Séance 6
La question du pouvoir dans les Lettres persanes (lettres 21, 24 et 80)
- Pourquoi la description des fonctions du roi et du pape dans la lettre 24 peut-elle paraître choquante pour un lecteur du XVIIIe siècle ? A travers Rica, que et qui remet en cause Montesquieu ?
- Dans les lettres 21 et 80, Rica semble se contredire avec deux prises de position paradoxales. Quelles sont-elles ?
Séance 6 : la question du pouvoir dans les Lettres persanes (synthèse des lettres 21, 24 et 80)
Vous l'avez très bien vu pour la plupart le regard de Montesquieu sur la religion et la politique est éminemment critique. Pour quelles raisons ?
Dans un premier temps, c'est à travers la métaphore du magicien que l'auteur met en oeuvre sa critique. Il associe dans la lettre 24 le roi et le pape à un prestidigitateur, faisant ainsi preuve d'irrespect vis-à-vis des traditions monarchiques et religieuses. En pleine monarchie de droit divin, il rend les actes et la parole du souverain contestables, notamment à travers une réforme politique (monétaire) qui consiste à persuader "qu'un écu en vaut deux". Sa référence au système de Law est explicite : Louis XV et sa politique monétaire sont remis en cause.
Plus loin dans cette même lettre, c'est le pape et sa bulle Unigenitus qui sont critiqués par une remise en question des lois fondamentales de l'Eglise catholique, l'eucharistie et la trinité : « tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu'un ; que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin ».
Dans un deuxième temps, à travers les lettres 21 et 80, Montesquieu assouvit un autre désir de critique : cette incapacité qu'ont les politiques à lier leur mode de vie personnel et leurs idées philosophiques, la théorie et la pratique. Ainsi voyons-nous Usbek condamner la tyrannie sous toutes ses formes alors que lui-même se comporte en tyran avec son eunuque.
Les Lettres persanes comportent donc bien cette visée morale propre à la philosophie des Lumières.
"C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser".

Séance 7 : lecture 2, lettre 80
La sévérité d'une punition ne dissuade pas de transgresser les règles.
Compte, mon cher Rhédi, que dans un État, les peines plus ou moins cruelles ne font pas que l'on obéisse plus aux lois. Dans les pays où les châtiments sont modérés, on les craint comme dans ceux où ils sont tyranniques et affreux.
Soit que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel, on punit toujours par degrés : on inflige un châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou moins grand. L'imagination se plie d'elle-même aux mœurs du pays où l'on vit : huit jours de prison, ou une légère amende, frappent autant l'esprit d'un Européen, nourri dans un pays de douceur, que la perte d'un bras intimide un Asiatique. Ils attachent un certain degré de crainte à un certain degré de peine, et chacun la partage à sa façon : le désespoir de l'infamie vient désoler un Français condamné à une peine qui n'ôterait pas un quart d'heure de sommeil à un Turc.
D'ailleurs je ne vois pas que la police, la justice et l'équité soient mieux observées en Turquie, en Perse, chez le Mogol, que dans les républiques de Hollande, de Venise, et dans l'Angleterre même ; je ne vois pas qu'on y commette moins de crimes ; et que les hommes, intimidés par la grandeur des châtiments, y soient plus soumis aux lois.
Je remarque, au contraire une source d'injustice et de vexations au milieu de ces mêmes États.
Je trouve même le prince, qui est la loi même, moins maître que partout ailleurs.
Je vois que, dans ces moments rigoureux, il y a toujours des mouvements tumultueux, où personne n'est le chef ; et que, quand une fois l'autorité violente est méprisée, il n'en reste plus assez à personne pour la faire revenir ;
Que le désespoir même de l'impunité confirme le désordre et le rend plus grand ;
Que, dans ces États, il ne se forme point de petite révolte, et qu'il n'y a jamais d'intervalle entre le murmure et la sédition ;
Qu'il ne faut point que les grands événements y soient préparés par de grandes causes ; au contraire, le moindre accident produit une grande révolution, souvent aussi imprévue de ceux qui la font que de ceux qui la souffrent.
De Paris,
le 2 de la lune de Rébiab 1, 1715.
Plan de l'explication :
Lignes 1 à 14 du livre (de "Compte..." à "... un Turc.") : la thèse d'Usbek et son illustration
Lignes 15 à 23 (de "D'ailleurs..." à "... partout ailleurs.") : de l'expérience à la théorie
Lignes 24 à la fin : les régimes s'exerçant par le despotisme sont inefficaces.
Quelques pistes pour l'oral
Éléments d'introduction :
Énoncez ensuite le plan d'étude linéaire que vous avez retenu. Le
voici :
N'oubliez pas de lire l'extrait à voix haute - c'est obligatoire - pour vous en imprégner.
Votre développement (n'oubliez pas que chacune de vos remarques doit s'accompagner d'une justification : une citation, une ligne, une figure de style ou un procédé grammatical) : quelques idées possibles.
Lignes 24 à la fin : les régimes s'exerçant pas le despotisme
sont inefficaces.
Votre conclusion doit rappeler l'essentiel de ce que vous avez développé.
Mais elle doit aussi confirmer, comme vous l'avez suggéré dans l'introduction,
que l'extrait constitue bien une réflexion d'ordre politique. Vous pouvez enfin
ouvrir la perspective de plusieurs façons : soit évoquer une autre lettre
proposant une réflexion du même ordre (voir séance précédente), soit élargir
vers une autre œuvre de Montesquieu : on peut à ce titre citer la théorie de
l'auteur selon laquelle il faut adapter les coutumes et les lois à l'esprit d'un
pays, théorie présente dans l'œuvre intitulée De l'esprit des lois.
Séance 10 : lecture 3, lettre 161 (le suicide de Roxane)
Une fois n'est pas coutume, commençons par un questionnaire préparatoire à remplir avant samedi 4 avril et après avoir lu la lettre 161 dans son intégralité.